Médecine: hacker ouvert?
La médecine est douée pour amasser le plus de connaissances possibles afin de soigner des patients. Parfois, quand elle est à cours de ressources, il convient cependant de la détourner de ses procédés habituels pour le bien du malade.
J’aime bien une émission de France culture, « Place de la toile ». Pour ceux qui s’intéressent aux cultures numériques mais qui ne sont que des béotiens, comme moi, c’est toujours passionnant. L’idée de cette note est née de l’écoute d’une émission sur l’histoire du Hacking. J’en avais écrit une première version qui est toujours en friche et le restera certainement. Cette nouvelle note est catalysée par des lectures récentes sur l’éthique médicale, une réunion institutionnelle sur les molécules onéreuses prescrites hors autorisation de mise sur le marché (AMM), une note de l’ami Jean-Marie qui reprend les propositions révolutionnaires de notre ministre de tutelle et une histoire récente.
J’ai découvert qu’Apple était né grâce au hacking des compagnies téléphoniques américaines en utilisant la blue box du Captain Crunch. Il est tout a fait fascinant de voir l’évolution de Steve Jobs, fabriquant des blue boxes [en], les revendant pour acheter du matériel, créer le premier Mac et, 30 ans plus tard, se transformer en créateur d’un des systèmes les plus fermés et propriétaires du monde. Comment le pirate de AT&T devient le créateur de iTunes et de l’Apple store ? La métamorphose est passionnante. Elle illustre à mon avis un des risques de l’obsession de normalisation de notre société que traduisent certaines mesures du plan de M. le Ministre comme:
Détection et suivi de l’usage “hors AMM” des médicaments afin d’identifier les pratiques à risque.
Par définition, une prescription hors AMM est perçue comme dangereuse, alors qu’elle pourrait aussi être perçue comme un vecteur d’innovation. Quand on détourne de son usage un objet, il en sort parfois du bon. Je suis convaincu que la sortie du net du milieu militaire et universitaire est un bien. Ces mesures sont prises à la va vite sous la pression de l’affaire du Médiator. Le système est défensif. Il repose uniquement sur le flicage plutôt que sur la formation, la responsabilisation et la mise en confiance des différents acteurs. La médecine défensive [en], contrairement à ce que de nombreuses personnes croient, coûte chère et n’améliore pas la qualité des soins.
On veut normaliser pour que rien ne dépasse, pour vivre dans un cocon douillet, sans risque, dans une illusion de maîtrise, alors que la vie n’est que prise de risques et aléas.
Le médecin, ce hacker
La médecine est une activité à risque. Nous jouons avec la camarde une partie perdue d’avance. Notre but n’est que de la faire durer un petit peu plus. Il faut répondre à la souffrance du patient, à ses angoisses, à ses questions, à sa peur de la mort ou du handicap. Chaque individu est unique et nous devons faire l’inverse du scientifique. Nous partons du général pour aller au cas particulier en maîtrisant le mieux possible nos maigres connaissances. C’est ici que le médecin rejoint parfois le hacker.

Il y a un problème, un obstacle, un symptôme, une maladie. On applique un code ou un programme ou une démarche diagnostique ou thérapeutique qu’on a utilisé 100 fois et patatra, ça ne fonctionne pas. Que faire ? Il y a deux solutions :
- Détourner le regard et dire je ne rentrerai jamais dans ce système, il est trop bien protégé, ce symptôme, ce malade que je ne comprends pas je ne le vois pas, je scotomise ce bilan incompréhensible.
- Ce firewall, ces mesures de protection, je vais les briser pour aller voir derrière, ce patient qui souffre mérite une solution unique pour lui et il va falloir mettre les mains dans le cambouis et trouver le bon code qui apportera une réponse la moins mauvaise possible.
Le hacker informaticien a une chance par rapport au hacker médecin, le code est connu (je me trompe peut-être, mes compétences et connaissances dans le domaine sont limitées). Le médecin utilise un code qui est partiellement connu, parfois il jongle plutôt avec du vide conceptuel que de la science bien ferme. Ce n’est pas forcément la chose la plus facile, trouver une solution quand on ne sait pas comment tout marche.
Dans de multiples situations nous nous retrouvons à bidouiller les prescriptions ou parfois ne prescrivons pas et bidouillons avec des mots quand nous arrivons au bout de nos ressources. La médecine est belle pour ça, amasser des connaissances, le plus de connaissances, que nous espérons les plus solides possibles et les appliquer à un patient avec son histoire, son terrain, sa subjectivité. Trafiquer le mieux possible pour que l’homme malade face à nous aille mieux. Parfois, il suffit de suivre la littérature, ce que nous avons appris à l’école. Nous ne réinventons pas la roue tous les jours, il faut juste des petits ajustements, des réglages de rien. Parfois malgré un diagnostic, nous ne faisons pas ce qu’il faudrait car en face de nous, il y a un sujet. Parfois on négocie avec sa conscience, on renonce à la perfection pour faire moins mal. Parfois nous nageons dans l’inconnu et là, c’est le grand bricolage, la quête d’une attitude la plus raisonnable. Mais, parfois, il faut oser.
Nous devons garder une certaine liberté de prescription sous la réserve de pouvoir toujours justifier de la façon la moins irrationnelle nos choix. La décision collégiale est une aide. L’écriture dans le dossier médical, pour qu’il reste une trace de notre cheminement et de nos choix, est essentielle.
Voici un exercice sain, justifier nos choix quand la science ne nous aide pas à décider, ou même si il y a du très solide. Nous trafiquons avec le patient, en partenariat, pour essayer de trouver la solution la plus adéquate. Parfois il ne faut pas transiger, parfois il faut faire preuve de souplesse, pas de dogmatisme mais de l’adaptation. On nous ferme la porte, je rentre par la fenêtre, car fracasser la porte n’est pas une solution. Comme le hacker, il faut connaitre les commandes du code ou du réseau le plus parfaitement possible.

“Surveiller mais ne pas brider”
Pour être libre, il faut savoir. Le savoir libère. Ce n’est pas pour rien que les dictatures brûlent les livres. La confrontation à la difficulté qui met en échec nos maigres connaissances nous rend meilleur si nous nous donnons la peine d’utiliser notre système nerveux central. J’aime toujours autant la clinique pour cette raison.
Le malade arrive avec son problème, et notre rôle est de trouver la solution la plus élégante possible. Quand vous écoutez des programmeurs, il y a une dimension de beauté dans du code bien écrit ou dans une solution trouvée qui ne passe pas par la force brute, l’éternel lutte entre Thor et Loki. Je préfère Loki, même si beaucoup trouvent que j’ai souvent une approche brutale. J’utilise ce que je veux quand je pense que c’est nécessaire.
Il faut que la régulation fasse très attention en voulant limiter nos possibilités de prescrire des molécules onéreuses ou non hors AMM. Certaines maladies rares, sans être exceptionnelles, ne feront pas l’objet d’études bien réalisées pour plein de raisons. La prescription hors AMM et hors étude peu apporter une preuve de concept qui permettra d’initier un essai randomisé. La prescription hors AMM peut permettre d’améliorer le soin. Ne diabolisons pas une pratique qui peut nous aider. Il faut un encadrement, il faut protéger les patients des fous, mais quand je vois qu’on laisse Simoncini en liberté, je me dis qu’il y a du travail. Il faut une culture du hors AMM, savoir analyser sa pratique, reprendre les cas et faire le point à intervalles réguliers. La discussion formalisée est un outil indispensable.
Il faut surveiller mais ne pas brider ceux qui vont à la limite pour l’intérêt du patient. Chercher une solution originale ou du moins sortant des sentiers battus pour éviter que mon patient ne finisse en dialyse, c’est un bel objectif.
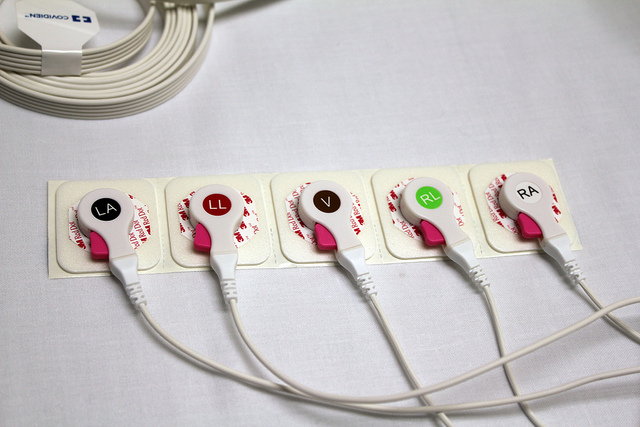
La quête de l’équilibre, oui j’y reviens toujours. J’aime trop la physiologie rénale pour ne pas aimer la beauté de l’équilibre. L’équilibre dans le monde du vivant est dynamique, avec des mises en tensions dans un sens, dans un autre, et chaque fois le retour à un état compatible avec la vie. Ce nouvel état n’est pas forcément équivalent au précédent. La maladie est un bon exemple. Elle nous transforme. Je n’aime pas l’époque actuelle car elle voudrait comme un ordinateur ne réfléchir qu’en 0 et 1 (bien ou mal), comme si entre ces deux chiffres, il n’y avait pas une infinité de nombres. J’aimerais pouvoir dans mon activité dire chaque fois, c’est bien, c’est mal. Malheureusement dans de nombreux cas, il est impossible de trancher et on trafique avec sa conscience, avec les désirs du patient. Passionnant, non?
Une petite histoire
Il a 20 ans, une mère folle et une insuffisance rénale chronique terminale. Il est hospitalisé en psychiatrie pour échapper à la folie de sa génitrice. Il est débile léger. Je l’ai rencontré la première fois, il y a deux semaines, je remplaçais l’interne parti en DU. J’en entendais parler depuis quelques temps. J’ai un peu bidouillé son traitement. L’idée était d’attendre sa sortie pour qu’il retrouve son néphrologue traitant en ville. L’hospitalisation s’éternisant et refusant de jouer au “je te remplis pour ne pas voir la créatininémie monter trop vite“, comme il commence à vomir, je décide que c’est l’heure. 850 de créat quand tu pèses 50 kg, ce n’est pas trop bon. J’appelle mon collègue de la dialyse qui me trouve une petite place. Première séance, il refuse, deuxième séance même histoire. Jeudi, la troisième. Je l’ai vu deux fois, je lui avais parlé de l’importance de la dialyse et j’avais cru qu’il m’avait compris. Manifestement, j’ai échoué. J’ai dis à mes petits camarades de m’appeler si ils avaient un problème et évidement… Jamais deux sans trois.
Allo stéphane, il veut pas.
J’arrive dans le box de dialyse. Il est allongé. Il est très anxieux. L’interne de psychiatrie l’a accompagné. Il ne veut pas étendre le bras. Nous discutons. Brutalement, il explose:
Non,non, non, non.
Il ne sait dire que non. Il se replie en position fœtale, pauvre petit oiseau mort de trouille entouré par nos blouses, nos machines, nos aiguilles.
L’infirmière lui parle, l’interne lui parle, je lui parle. Je veux comprendre, je veux savoir pourquoi non. Je veux entendre ses mots au delà du non et en réponse encore “non, non, non”. Pourquoi non? Il ne peut pas le dire, ça dure. La solution de facilité : lâcher. Je n’ai pas envie, les trois soignants réunis autour du lit, nous n’en avons pas envie. Il faudra un jour le dialyser, commencer la technique. Ce ne peut pas être en catastrophe sur un OAP ou une hyperkalièmie. J’ai envie pour lui, et à l’instant présent contre lui, que la première séance se fasse dans le calme de la fin d’une après midi ensoleillée de juin et pas une froide nuit de garde de décembre avec des neuroleptiques dans les fesses. Il résiste, se replie, se ferme. Les mots ne sortent pas, je veux qu’il me regarde, je veux qu’il pose des mots sur son angoisse, sa terreur, pour ne pas rester avec ce rien. Le vide du mot “non” est insupportable.

Il y a derrière son non autre chose, le refus de la ponction de la pénétration de sa peau par l’aiguille tenue par une femme? Je ne saurai jamais, peut-être juste la peur de l’inconnu, mais je ne crois pas, c’est plus complexe, je ne suis pas psychiatre, juste néphrologue bourrin de base.
Je parle, nous parlons. Je continue dans mon approche monomaniaque. Je veux des mots. Il est insupportable celui qui veut des mots alors que vous ne pouvez rien dire. Toute votre vie on vous a appris que les mots sont dangereux. Alors finalement l’aiguille tenue par une jeune fille qui sourit, fait moins peur. D’un coup par mon obstination enfantine, le sourire paisible de l’infirmière et le calme de l’interne de psychiatrie, il lache, il se rallonge, il tend le bras.
On y va. Je reste. Le moment est difficile, heureusement l’emla ça marche. L’infirmière pose la première aiguille. Il me regarde dans les yeux, je ne veux pas qu’il voit la pénétration du biseau dans sa peau. Je lui parle, il préfère à mes yeux, le décolleté de l’interne de psy. Ça y est, il n’a rien senti, on fixe. Il s’agite à nouveau, il n’est pas loin d’arracher l’aiguille. Je continue à parler, à raconter je ne sais plus quoi sur un mode automatique. Il se calme, il allonge le bras, la deuxième aiguille est en place. Il n’a pas mal. L’infirmière le branche, la machine tourne, le sang rencontre le filtre. C’est parti pour trois heures. Nous le félicitons de son courage, d’avoir pu surmonter sa peur. Je suis content. Nous n’avons pas eu besoin de sédation, juste de parler de trouver la clé pour l’aider. Rien n’est définitif, je ne pourrai pas assister à tous les branchements, ce ne pourra pas toujours être la même infirmière… Nous verrons, à chaque jour suffit ça peine.
C’est ça la médecine, être ensemble autour d’un problème qui peut paraitre trivial: “brancher en dialyse un patient qui ne veut pas“. Il est hors de question de le contraindre physiquement ou chimiquement. Nous sommes trois, nous ne nous sommes jamais rencontrés avant et pourtant après 3/4 heure, tendus vers le même objectif avec nos histoires, nos vécus, nos expériences différentes, nous avons réussi avec un outil élégant, libre et gratuit, la parole (le code premier et ultime, le langage) à résoudre ce problème qui pouvait paraître sans issue.
La ténacité est importante en médecine.
Quel métier passionnant…
Article initialement publié sur “PerrUche en Automne” sous le titre “De la médecine comme une forme de hacking”.
Photos Flickr CC ![]()
![]()
![]() par Divine Harvester,
par Divine Harvester, ![]()
![]()
![]() par PhOtOnQuAnTiQuE,
par PhOtOnQuAnTiQuE, ![]()
![]()
![]() par daedrius,
par daedrius,![]()
![]() par quinn.anya,
par quinn.anya, ![]() par molotalk.
par molotalk.

Laisser un commentaire